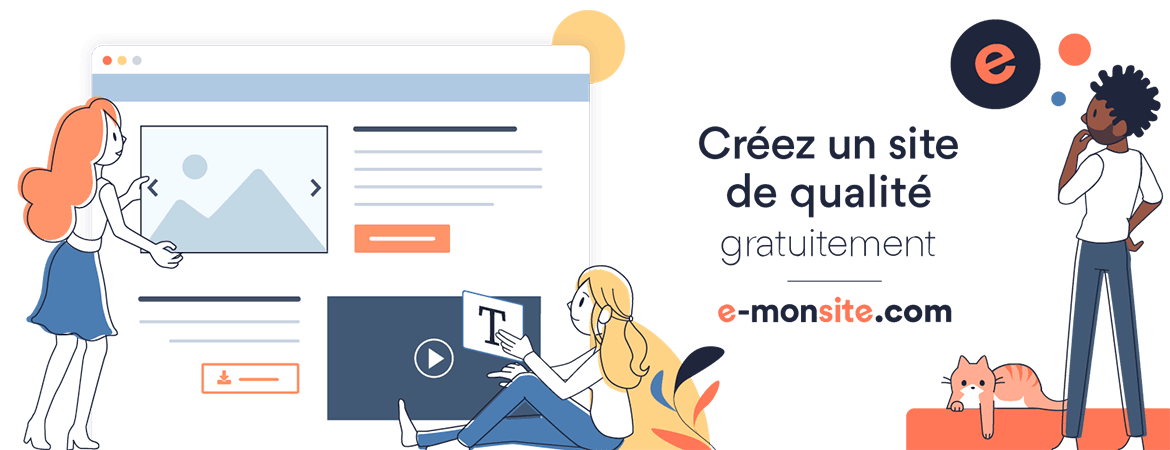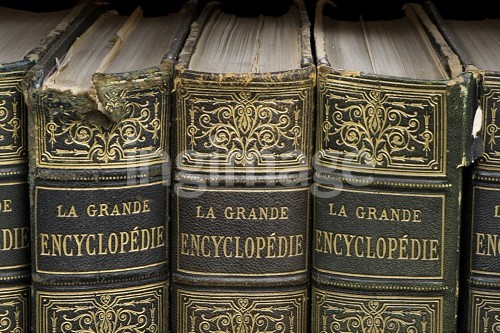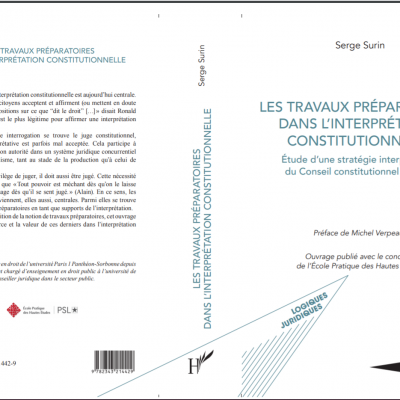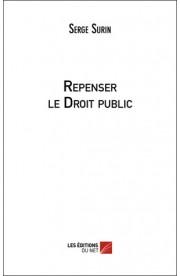L'obligation de quitter le territoire français face aux droits et libertés constitutionnellement garantis
L'obligation de quitter le territoire français face aux droits et libertés constitutionnellement garantis
Brèves chroniques de jurisprudence constitutionnelle
Droits et libertés fondamentaux
Les 1er et 8 juin 2018, le Conseil constitutionnel a rendu deux décisions portant sur les droits et libertés fondamentaux qui méritent d’être soulignées. Ces deux décisions sont à rapprocher d'une autre plus récente rendue le 19 octobre 2018 (Décision n° 2018-741 QPC du 19 octobre 2018, §§. 14 et 15. M. Belkacem B. [Délai de recours contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière]).
- Décision n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018, §§9 et 10. Section française de l’observatoire international des prisons et autres [Délais de recours et de jugement d’une obligation de quitter le territoire français notifiée à un étranger en détention].
Brevitatis causa, le paragraphe III de l’article L. 512-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit que, lorsqu’un étranger se voit notifier une obligation de quitter le territoire français (OQTF) en même temps que son placement en rétention administrative ou son assignation à résidence, il peut demander l’annulation de cette obligation devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Cette juridiction statue alors sur ce recours au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. Le paragraphe IV de ce même article applique ces délais à l’étranger en détention auquel a été notifiée une OQTF.
Autrement dit, le législateur enfermait l’étranger se trouvant dans une situation de rétention (ou de détention) et ayant fait l’objet d’une OQTF dans un délai de cinq jours à compter de la notification de celle-ci pour la contester, délai que le Conseil constitutionnel juge insuffisant au regard du droit constitutionnel à un recours juridictionnel effectif. Ainsi, si l’objectif poursuivi par le législateur, qui est d’éviter le placement de l’étranger en rétention administrative à l’issue de sa détention, n’est pas contestable en soi, il aurait dû mieux concilier cet objectif avec le droit à un recours juridictionnel effectif, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
En effet, le Conseil constitutionnel a décidé : « en enserrant dans un délai maximal de cinq jours le temps global imparti à l’étranger détenu afin de former son recours et au juge afin de statuer sur celui-ci, les dispositions contestées, qui s’appliquent quelle que soit la durée de la détention, n’opèrent pas une conciliation équilibrée entre le droit au recours juridictionnel effectif et l’objectif poursuivi par le législateur d’éviter le placement de l’étranger en rétention administrative à l’issue de sa détention » (§9).
Une telle analyse du Conseil constitutionnel a conduit à l’abrogation avec effet immédiat de la disposition législative contestée : « Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, les mots « et dans les délais » figurant à la première phrase du paragraphe IV de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être déclarés contraires à la Constitution. » (§10).
Cette décision, en termes d’effectivité de l’exercice des droits et libertés fondamentaux, est importante car elle montre que le Conseil constitutionnel paraît prendre le législateur dans son propre piège en l’invitant à être politiquement plus cohérent. En effet, en enfermant des étrangers faisant l’objet d’une OQTF, alors qu’ils sont privés de liberté, dans un délai aussi bref pour saisir le juge, sachant qu’ils peuvent sans doute avoir besoin d’un avocat et, probablement, d’un interprète, ce qui exige beaucoup de temps, le législateur ne semblait pas vouloir un exercice effectif de ce droit au juge ; il s’agissait alors d’un leurre faisant croire à l’étranger se trouvant dans cette situation qu’il avait le droit de recourir à un juge alors même que, sur le plan pratique, tout a été fait par le législateur pour que ce droit ne soit pas effectivement exerçable et exercé.
À peine une semaine plus tard, le 8 juin 2018, le juge de la rue de Montpensier a encore rendu une décision de haute portée au regard des droits et libertés fondamentaux.
- Décision n° 2018-712 QPC du 8 juin 2018, §§11-14. M. Thierry D. [Irrecevabilité de l'opposition à un jugement par défaut lorsque la peine est prescrite].
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel devait répondre à la question de savoir si un condamné par contumace (ou par défaut) pouvait être empêché de s’opposer au jugement de condamnation du simple fait que la peine devient prescrite alors même que cette condamnation emporte de graves conséquences par ailleurs, notamment sur le plan civil, pour le condamné.
En effet, l’article 492 du Code de procédure pénale dispose : « Si la signification du jugement n’a pas été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d’huissier de justice ou à parquet : dix jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine, un mois s’il réside hors de ce territoire.
Toutefois, s’il s’agit d’un jugement de condamnation et s’il ne résulte pas, soit de l’avis constatant remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d’un acte d’exécution quelconque, ou de l’avis donné conformément à l’article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l’opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu’à l'expiration des délais de prescription de la peine.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le délai d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance. »
En outre, l’article 133-5 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1992, quant à lui, précise : « Les condamnés par contumace ou par défaut dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace ou à former opposition. »
Le requérant, avec succès, contestait ces dispositions au motif qu’elles sont contraires, d’une part, au droit à un recours juridictionnel effectif, dès lors qu’elles interdisent à une personne, condamnée par défaut pour un délit, de contester cette condamnation lorsque la peine est prescrite, y compris si elle n’en a pas eu connaissance avant cette prescription ; d’autre part, aux droits de la défense, dès lors que la personne condamnée serait également, dans une telle hypothèse, sanctionnée de manière définitive sans avoir pu à quelque moment et de quelque manière que ce soit présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés ; en outre, le Conseil constitutionnel avait admis dans cette affaire l’intervention d’une autre partie dont les griefs rejoignaient ceux du requérant ; mais celle-ci soutenait également que l’impossibilité de remettre en cause la décision de condamnation, en ce qu’elle porte sur les intérêts civils, viole le droit de propriété.
Après avoir constaté que « la personne condamnée par défaut peut, lorsqu’elle prend connaissance de la signification de la décision de condamnation postérieurement à la prescription de la peine, se trouver dans l’impossibilité de contester cette décision que ce soit par la voie de l’opposition ou par celle de l’appel » (§11), le Conseil constitutionnel a conclu : « en privant la personne condamnée par défaut de la possibilité, lorsque la peine est prescrite, de former opposition, lorsqu’elle n’a pas eu connaissance de sa condamnation avant cette prescription et alors que des conséquences restent attachées à une peine même prescrite, les dispositions contestées portent une atteinte excessive aux droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif. » (§13).
Par conséquent, « sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, les mots « jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine » figurant au deuxième alinéa de l’article 492 du code de procédure pénale et les mots « ou par défaut » et « ou à former opposition » figurant à l’article 133-5 du code pénal doivent être déclarés contraires à la Constitution. » (§14). Et, là encore, l’inconstitutionnalité prend effet immédiatement.
Le prononcé d’une telle inconstitutionnalité était attendu. En effet, même si la peine est prescrite, la condamnation demeure, et celle-ci pourra être prise en compte en cas de récidive par exemple. De plus, cette condamnation pourra être inscrite de manière définitive au casier judiciaire de la personne condamnée, ce qui lui interdira notamment l’exercice de certaines fonctions, publiques comme privées, ou encore de passer des concours de l’administration publique.
Enfin, on l’aura remarqué, le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur le grief supplémentaire avancé par la partie intervenante selon lequel les dispositions contestées portaient également atteinte au droit de propriété. Mais ce silence ne signifie pas que le Conseil constitutionnel rejette cet argument, car l’inconstitutionnalité prononcée, qui remet le condamné par défaut dans ses droits, emporte neutralisation de toutes les conséquences négatives des dispositions en cause, y comprises celles pouvant affecter négativement le droit de propriété du condamné et de ses ayants droits.
Serge SURIN
Vendredi 8 juin 2018
Ajouter un commentaire