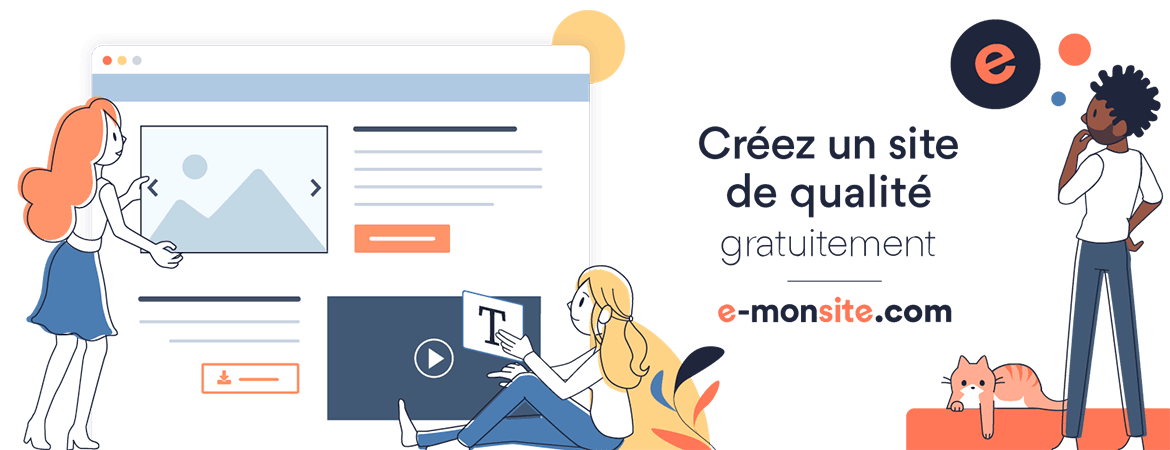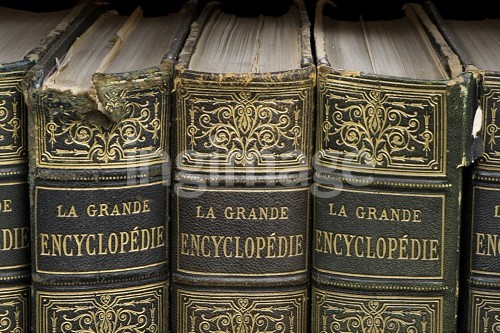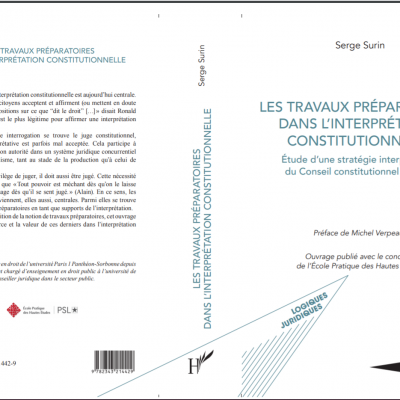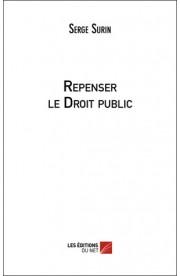Loi anticasseurs, frais irrépétibles en matière pénale, inviolabilité du domicile, contestation du règlement intérieur du CC (« portes étroites »)
Chronique de jurisprudence constitutionnelle du lundi 15 avril 2019
Décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019
Loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations
La proposition de loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations avait fait couler beaucoup d’encre au sens où elle a été très médiatisée et très contestée pour son caractère et son contenu « liberticides ». L’expression « loi anticasseurs », son surnom, qui demeure dans toutes les mémoires[1], en témoigne.
Votée le 12 mars 2019, le Conseil constitutionnel a été saisi dès le lendemain de la conformité de cette proposition de loi à la Constitution tant par 60 députés et 60 sénateurs que par le président de la République. Les dispositions les plus contestées du texte, celles de son article 3, ont, par la décision présentement analysée, été déclarées contraires à la Constitution sur le fondement d’une variante assez récente de la liberté d’expression : la notion de « droit d’expression collective des idées et des opinions ».
Cette notion, qui est une innovation de la jurisprudence constitutionnelle[2] découlant de l’article 11 de la DDHC de 1789, a, en effet, été au cœur de cette décision du Conseil constitutionnel[3].
Rappelons que cet article 3 prévoyait la possibilité pour l’autorité administrative (policière) de prononcer de manière préventive une interdiction assez arbitraire de manifester à l’égard d’une personne sans l’intervention d’un juge.
Le Conseil constitutionnel a, juridiquement sans surprise, jugé que « les dispositions contestées laissent à l’autorité administrative une latitude excessive dans l’appréciation des motifs susceptibles de justifier l’interdiction[4] ».
Ainsi, « compte tenu de la portée de l’interdiction contestée, des motifs susceptibles de la justifier et des conditions de sa contestation, le législateur a porté au droit d’expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, l’article 3 est contraire à la Constitution[5] ».
Les conditions et motifs du prononcé de l’interdiction établies par les dispositions législatives contestées étaient (puisqu’elles ont été annulées) les suivants :
- L’interdiction pouvait être prononcée même si le comportement en cause ne présente aucun lien avec les atteintes graves à l’intégrité physique ou les dommages importants aux biens ayant eu lieu à l’occasion de cette manifestation (motif qui a été retenu comme base de l’interdiction).
- L’interdiction pouvait être prononcée sur le fondement de tout agissement, que celui-ci ait ou non un lien avec la commission de violences.
- Tout comportement, quelle que soit son ancienneté, pouvait justifier le prononcé d’une interdiction de manifester.
- Pour une manifestation non déclarée ou déclarée tardivement sur la voie publique, l’interdiction de manifester était exécutoire d’office et pouvait être notifiée à tout moment à la personne visée, y compris au cours de la manifestation concernée (impossible de ne pas reconnaître ici une disposition de nature particulière visant une figure spécifique du mouvement des Gilets jaunes : celle d’Éric Drouet).
- L’interdiction administrative pouvait concerner toute manifestation sur la voie publique sur l’ensemble du territoire national pendant une durée d’un mois.
Ce faisceau de conditions-motifs, toutes problématiques, les unes que les autres, du point de vue politique et démocratique, ne pouvait, juridiquement, que conduire le Conseil constitutionnel à annuler la décision du législateur.
Il convient de conclure, sur ce point, que les lois visant à restreindre les droits et libertés des individus ne sont pas seulement dangereuses du fait de leur contenu mais aussi du fait que leur interprétation par le juge constitutionnel peut présenter un caractère équivoque aigu. En effet, au regard des justifications conduisant le Conseil constitutionnel à déclarer conformes à la Constitution d’autres dispositions de la loi contestée, on ne voit pas véritablement ce qui l’aurait empêché de prendre la position inverse en déclarant conforme à la Constitution cette interdiction administrative de manifester. Il s’agit d’une question de choix de l’interprétation retenue. Un Conseil constitutionnel légèrement autrement composé pourrait en décider autrement.
De plus, avec les hommes politiques qui sont nommés en masse au Conseil constitutionnel, il est à craindre que la sympathie politique que les membres de cette institution pourraient manifester à l’égard de tel ou tel président de la République, de tel ou tel Premier ministre ou de tel ou tel ministre de l’intérieur les conduise à tout moment à justifier la constitutionnalité de n’importe loi restreignant les droits et les libertés.
D’ailleurs, si le président de la République a, le 13 mars 2019, depuis Nairobi, trouvé nécessaire de cosaisir le Conseil constitutionnel alors même qu’il n’y était nullement contraint et alors même que l’institution a le même jour déjà été saisie par 60 députés et 60 sénateurs, il se pourrait que c’est par stratégie afin de tenter de conduire les membres du Conseil à occulter les arguments des parlementaires pour ne voir que la figure du « président-totem » et « tout-puissant » qui, selon certaines études sociologiques et politiques[6], fait encore rêver et tourner la tête de tant de Français ; alors pourquoi ne pas tenter d’attiser la sympathie envers le pouvoir présidentiel dans l’objectif de valider la loi liberticide ?
Décision n° 2019-773 QPC du 5 avril 2019
Société Uber B.V. et autre [Frais irrépétibles devant les juridictions pénales II]
L’un des éléments sinon l’élément le plus important à retenir de cette décision est que le Conseil constitutionnel affirme qu’« Aucune exigence constitutionnelle n’impose qu’une partie au procès puisse obtenir du perdant le remboursement des frais qu’elle a exposés en vue de l’instance[7] ». Cela suppose que le législateur est libre d’imposer ou non une telle exigence s’il le souhaite. Mais, concrètement, que signifie ce langage ? On y reviendra.
Le Conseil constitutionnel constate qu’« en application des articles 375 et 475-1 du code de procédure pénale, une juridiction de jugement peut condamner l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci pour sa défense[8] ». Pour le juge de la rue de Montpensier, si le législateur est libre de laisser une telle possibilité au juge, « la faculté d’un tel remboursement affecte l’exercice du droit d’agir en justice et les droits de la défense[9] ».
La question se pose alors de savoir de quelle manière une telle faculté de remboursement affecte l’exercice du droit d’agir en justice et les droits de la défense. La rédaction de l’article 800-2 du Code procédure pénale fournit les éléments de réponse à cette question ainsi qu’à celle déjà posée plus haut.
Comme le constate le Conseil constitutionnel, cette disposition « permet à la juridiction de jugement prononçant une décision de relaxe ou d’acquittement d’accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité, supportée par l’État ou la partie civile, au titre des frais non payés par l’État et exposés par cette personne pour sa défense[10] ».
Mais, toujours au regard du texte précité, « lorsque la personne poursuivie a été condamnée, ni ces dispositions ni aucune autre ne permettent à la personne citée comme civilement responsable d’obtenir devant la juridiction pénale le remboursement de tels frais, alors même qu’elle a été mise hors de cause[11] ». Cela signifie que lorsque la responsabilité civile d’une personne poursuivie pénalement a été engagée et que le juge a finalement déclaré qu’elle est irresponsable sur le plan civil, elle doit pouvoir bénéficier du remboursement des frais qu’il a exposé pour sa défense ; alors que jusque-là la seule condamnation pénale suffisait à exclure tout remboursement de frais par ailleurs exposés pour la défense civile de la personne citée.
Ainsi, ces dispositions « doivent être déclarées contraires à la Constitution[12] » car « les dispositions du premier alinéa de l’article 800-2 du code de procédure pénale portent atteinte à l’équilibre du droit des parties dans le procès pénal[13] ».
Pour autant, le Conseil constitutionnel a jugé que l’« abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de supprimer le droit reconnu à la personne poursuivie et à la personne civilement responsable de se voir accorder des frais irrépétibles en cas de non-lieu, de relaxe, d’acquittement ou de toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale[14] » et « entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives[15] ». Pour éviter ces inconvénients, le Conseil constitutionnel a renvoyé l’entrée en vigueur de cette abrogation « au 31 mars 2020[16] ».
Enfin, toutefois, comme il a pris coutume de le faire depuis 2016[17], le Conseil constitutionnel a pris une mesure transitoire dans l’attente de l’intervention correctrice du législateur en vue de remédier à l’inconstitutionnalité prononcée et ainsi d’éviter que l’entrée en vigueur immédiate de celle-ci aggrave la situation des justiciables. En effet, le Conseil constitutionnel a conclu qu’« il y a lieu de juger, pour les décisions rendues par les juridictions pénales après cette date, que les dispositions du premier alinéa de l’article 800-2 du code de procédure pénale doivent être interprétées comme permettant aussi à une juridiction pénale prononçant une condamnation ou une décision de renvoi devant une juridiction de jugement, d’accorder à la personne citée comme civilement responsable, mais mise hors de cause, une indemnité au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci[18] ».
Décision n° 2019-772 QPC du 5 avril 2019
M. Sing Kwon C. et autre [Visite des locaux à usage d’habitation par des agents municipaux]
Dans cette décision, les auteurs de la saisine du Conseil constitutionnel lui demandait, pour la première fois, sur le fondement du protocole n° 16 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de saisir pour avis consultatif la CEDH sur « l’interprétation de certains articles de cette convention[19] ». Sans l’ombre d’une justification, le Conseil constitutionnel balaie : « aucun motif ne justifie une telle saisine en l’espèce. Ces conclusions doivent être rejetées.[20] »
On peut clairement regretter cette attitude du Conseil constitutionnel qui, il faut le dire, n’est pas nouvelle. Mais pour la première application du protocole n° 16 à la CEDH, l’institution aurait pu exposer ce qu’il entend faire de ce dispositif, au sens de quel crédit il lui accorde au regard de son office et de sa légitimité, au lieu de battre en brèche la demande légitime des requérants sans aucune justification de nature à convaincre du bienfondé de sa décision.
S’agissant du fond de l’affaire, le législateur a, par l’article L. 651-6 du Code de la construction et de l’habitation, habilité les agents assermentés du service municipal du logement à visiter les locaux à usage d’habitation situés dans leur ressort de compétence, afin de constater les conditions d’occupation de ces locaux. Cette visite permet à ces agents de contrôler le respect des autorisations d’affectation d’usage des logements. En effet, certains logements peuvent être laissés vides ou sous-loués par leur occupant attitrés pendant que d’autres personnes rencontrant de réelles difficultés pour trouver un logement n’en disposent pas. De ce point de vue, l’habilitation législative de ces agents assermentés dans cet objectif paraît louable.
Cependant, le Conseil constitutionnel a constaté que ces dispositions exigent du gardien ou de l’occupant du local de laisser les agents effectuer cette visite, quoique dans des limites horaires bien définies, soit entre huit heures et dix-neuf heures, en sa présence (al. 5, art. L. 651-6 CCH). Par ailleurs, en cas de refus du gardien ou de l’occupant, ces dispositions autorisent lesdits agents assermentés à procéder de force à l’ouverture des portes et à visiter les lieux en présence du maire ou d’un commissaire de police (al. 5, art. L. 651-6 CCH).
Se fondant sur l’article 2 de la DDHC de 1789, duquel il voit « le droit au respect de la vie privée » et, en particulier, de « l’inviolabilité du domicile », le Conseil constitutionnel conclut : « En prévoyant ainsi que les agents du service municipal du logement peuvent, pour les motifs exposés ci-dessus, procéder à une telle visite, sans l’accord de l’occupant du local ou de son gardien, et sans y avoir été préalablement autorisés par le juge, le législateur a méconnu le principe d’inviolabilité du domicile[21] ». Dans ces conditions, « le sixième alinéa de l’article L. 651-6 doit donc être déclaré contraire à la Constitution[22] ».
En revanche, le législateur peut, sans méconnaître les droits de la défense, exiger des intéressés les titres, documents et autres pièces démontrant les conditions dans lesquelles le logement est occupé. Ainsi, « le droit reconnu aux agents assermentés du service municipal du logement, en vertu de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 651-7, de recevoir toute déclaration et de se faire présenter par les propriétaires, locataires ou autres occupants toute pièce ou document établissant les conditions dans lesquelles les lieux sont occupés ne saurait, en lui-même, méconnaître les droits de la défense ni le droit à un procès équitable.[23] »
De la même manière, « le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser ne fait pas obstacle à ce que l’administration recueille les déclarations faites par une personne en l’absence de toute contrainte. En outre, le droit reconnu aux agents assermentés du service municipal du logement de se faire présenter des documents tend non à l’obtention d’un aveu, mais seulement à la présentation d’éléments nécessaires à la conduite d’une procédure de contrôle du respect de l’autorisation d’affectation d’usage du bien. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.[24] »
Les intéressés auront compris qu’il n’y a aucune exigence juridique de dire la réalité de leur situation. Mais il semble tout de même nécessaire qu’ils fournissent des éléments permettant de procéder à la mission de contrôle des agents assermentés.
Enfin, s’agissant de l’inconstitutionnalité prononcée, le Conseil constitutionnel a jugé qu’« aucun motif ne justifie de reporter la prise d’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.[25] »
Cette décision doit bien embêter les agents assermentés qui sont désormais juridiquement empêchés de mener à bien leurs missions sans passer par la case juridiction.
Décision n° 2019-774 QPC du 12 avril 2019
Société Magenta Discount et autre [Contrôle des prix et des marges en Nouvelle-Calédonie]
On reproche souvent au Conseil constitutionnel d’avoir tendance à sacrifier les autres droits et libertés, à l’instar du droit au travail et à l’emploi prévu à l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946, au profit de la liberté d’entreprendre[26]. Tel ne semble pas être le cas, s’agissant de l’exercice de cette dernière liberté dans les territoires d’outre-mer où les contraintes économiques sont bien différentes des réalités de la métropole. C’est ce qui ressort dans cette décision n° 2019-777 QPC du 12 avril 2019. Ainsi, au nom d’« un objectif d'intérêt général de protection des consommateurs[27] » et « des particularités économiques de la Nouvelle-Calédonie[28] », le législateur du pays peut adopter des mesures visant à limiter les marges des entreprises. Cependant, la lutte du législateur du pays « contre des dérives sur les prix manifestement excessives » ne doit pas elle-même être excessive[29] sous peine de voir sa décision abroger par le Conseil constitutionnel[30].
En brefs
- Débat du 4 avril 2019 sur France 2 relatif aux élections européennes : TA de Paris / Conseil d’État sur le pluralisme politique (art. 4 de la Constitution).
Par requêtes déposées en mars 2019 devant les juges des référés du Tribunal administratif de Paris, trois candidats têtes de listes aux élections européennes, Benoît Hamon, Florian Philippot et François Asselineau, ont, notamment sur le foncement du principe pluralisme politique prévu au dernier alinéa de l’article 4 de la Constitution, demandé à ce tribunal d’enjoindre à France Télévisions de les inviter au débat que celle-ci organise le 4 avril 2019 entre d’autres candidats sur sa chaine France 2.
Par des ordonnances du 1er avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a accédé à la demande des requérants. C’est dans ces conditions que France Télévisions a, le 2 avril 2019, saisi le Conseil d’État en référé en vue que celui-ci annule les ordonnances du tribunal.
Par arrêt du 4 avril 2019, le Conseil d’État a effectivement accédé à la demande de France Télévisions en jugeant que « c’est à tort que, par les ordonnances attaquées, les juges des référés du tribunal administratif de Paris se sont fondés sur l’atteinte susceptible d’être portée à l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion, pour enjoindre à la société France Télévisions d’inviter au débat du 4 avril 2019, ou à un autre débat organisé avant le 23 avril, M. Hamon, M. Asselineau et M. Philippot.[31] » Mais, malgré cette ordonnance du Conseil d’État, sans doute pour éviter les critiques qui ne manqueraient pas de se faire entendre, « France 2 maintient cependant les invitations de Benoît Hamon, Florian Philippot et François Asselineau à son débat de ce soir sur les Européennes[32] ». Sans entrer dans les détails de l’affaire, on est tenté de dire que, si le Tribunal administratif de Paris se souciait de la liberté politique au détriment de la liberté de la presse, le Conseil d’État s’est montré, dans ce cas précis, plus protecteur de la seconde que de la première.
- Le Conseil d’État a été saisi contre l’inaction du Conseil constitutionnel en vue de remédier au manque de transparence des « portes étroites » (ou interventions de lobbyistes) introduits devant lui.
En octobre 2018, « les Amis de la Terre ont déposé un recours officiel devant le Conseil d’État, demandant que le Conseil constitutionnel se dote d’un règlement extérieur pour encadrer la procédure de contrôle de constitutionnalité, et notamment l’intervention des représentants d’intérêts[33] ». Ce recours visait à rendre plus transparents les « portes étroites » devant le Conseil constitutionnel, mécanisme défendu par certains sans convaincre qui que ce soit[34], mais dont l’opacité coïncide mal avec l’exigence de transparence des décisions d’un juge qui plus est un juge constitutionnel ayant un pouvoir de décision juridiquement incontestable par ailleurs dans l’ordre juridique interne.
Par un arrêt du 4 avril, le Conseil d’État a sans surprise rejeté ce recours[35] qui ne pouvait, en tout état de cause, aboutir ; on imaginait mal, en effet, que le Conseil d’État sanctionne le fait pour un organe juridictionnel qui lui est supérieur de s’abstenir de prendre une décision touchant au fonctionnement de sa mission juridictionnelle. Le Tribunal des conflits avait déjà tranché cette question en 1952 en distinguant les actes relevant de l’organisation du service public de la justice judiciaire et les actes de fonctionnement de ce service[36] ; ainsi, selon le Tribunal des conflits : « Considérant que les actes incriminés sont relatifs non à l’exercice de la fonction juridictionnelle mais à l’organisation même du service public de la justice ; que l’action des requérants a pour cause le défaut de constitution des tribunaux de première instance et d’appel dans le ressort de la Guyane, résultant du fait que le gouvernement n’a pas pourvu effectivement ces juridictions des magistrats qu’elles comportaient normalement ; qu’elle met en jeu la responsabilité du service public indépendamment de toute appréciation à porter sur la marche même des services judiciaires ; qu’il appartient dès lors à la juridiction administrative d’en connaître ». Le Conseil d’État a, dans son arrêt Falco rendu en 1953, soit seulement cinq mois plus tard, tiré les conclusions de la décision du Tribunal des conflits[37]. Néanmoins la question se pose de savoir si le Tribunal des conflits et le Conseil d’État oseraient se positionner ainsi s’agissant du Conseil constitutionnel. Rien n’est moins certain, mais le Conseil d’État semble ne pas vouloir prendre ce risque puisqu’il a dans l’arrêt du 11 avril 2019 précité pris le soin de préciser : « Il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des actes qui se rattachent à l’exercice par le Conseil constitutionnel des missions qui lui sont confiées par la Constitution ou par des lois organiques prises sur son fondement. Il en est ainsi de l’adoption ou du refus d’adopter des dispositions de son règlement intérieur sur le fondement de l’article 56 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Par suite, la requête de l’association Les Amis de la Terre France, portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, ne peut qu’être rejetée. » En ce sens, cette affaire montre au moins, une fois de plus, l’ambiguïté qui entache le système juridictionnel français en général et la justice administrative en particulier.
- Première saisine du Conseil constitutionnel sur le mécanisme du référendum d’initiative partagée (RIP) prévu à l’article 11 de Constitution
Le 10 avril 2019, le Conseil constitutionnel a été saisi pour la première fois à propos d’une proposition de référendum d’initiative partagée (RIP) visant à empêcher le gouvernement de privatiser les aéroports de Paris. Cette saisine a été enregistrée sous le n° 2019-1 RIP.
Au regard de l’article 2 de la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution[38], le Conseil constitutionnel dispose d’un mois pour contrôler la recevabilité du texte par rapport à la Constitution. Sa décision devrait donc intervenir d’ici le 11 mai 2019.
Il ne fait pas de doute que le Conseil constitutionnel validera la proposition qui respecte les conditions posées par l’article 11 de la Constitution. Il s’agit d’une opération importante de la vie démocratique française compte tenu des revendications du mouvement des Gilets jaunes qui réclament un référendum d’initiative citoyenne (RIC) permettant aux électeurs de pouvoir adopter et abroger des lois ou déchoir des élus de leurs fonctions.
Le pouvoir en place devrait être très prudent de manière ne pas donner à voir à la population qu’il chercherait à faire échec à cette initiative ; car l’échec de cette celle-ci pourrait radicaliser la revendication des Gilets jaunes qui découvriraient au grand jour que le RIP de l’article 11 de la Constitution est un leurre.
[1] « Gilets jaunes : la "loi anti-casseurs" de Castaner déjà décriée comme ‘liberticide’ », latribune.fr, 23 janvier 2019, https://www.latribune.fr/economie/france/gilets-jaunes-la-loi-anti-casseurs-de-castaner-deja-decriee-comme-liberticide-804850.html, Consulté le 8 avril 2019.
[2] Guy Carcassonne, « Les interdits et la liberté d’expression », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 36 (Dossier : La liberté d'expression et de communication), Juin 2012, https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/les-interdits-et-la-liberte-d-expression, Consulté le 8 avril 2019.
[3] Décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, §§. 8-10, 11-17, 18-26. Loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations.
[4] Ibid., §. 23.
[5] Ibid., §. 26.
[6] Baromètre CEVIPOF, 2017-2018.
[7] Décision n° 2019-773 QPC du 5 avril 2019, §. 5. Société Uber B.V. et autre [Frais irrépétibles devant les juridictions pénales II].
[8] Ibid., §. 6.
[9] Ibid., §. 5.
[10] Ibid., §. 7.
[12] Ibid., §. 8.
[13] Ibid.
[14] Ibid., 10.
[15] Ibid.
[16] Ibid.
[17] Sur ce point, v. Serge Surin, « Principe de fraternité et sauvegarde de l’ordre public. Une conciliation exigée par le Conseil constitutionnel », Revue 13 en droit, N° 2, Décembre 2018, pp. 17-29.
[18] Décision n° 2019-773 QPC du 5 avril 2019, Op. cit., 11.
[19] Décision n° 2019-772 QPC du 5 avril 2019, §. 7. M. Sing Kwon C. et autre [Visite des locaux à usage d’habitation par des agents municipaux].
[20] Ibid., §. 7.
[21] Ibid., §. 10.
[22] Ibid.
[23] Ibid., §. 13.
[24] Ibid., §. 14.
[25] Ibid., §. 17.
[26] Décision n° 2015-476 QPC du 17 juillet 2015, Cons. 13. Société Holding Désile [Information des salariés en cas de cession d'une participation majoritaire dans une société - Nullité de la cession intervenue en méconnaissance de cette obligation] ; Décision n° 2015-33 I du 22 décembre 2015, Cons. 5. Situation de M. Michel BOUVARD au regard du régime des incompatibilités parlementaires ; v. également Emilie Haroche, « L’éviction des actionnaires validée par le Conseil constitutionnel au nom du droit à l’emploi », Option Finance n° 1332, Lundi 14 septembre 2015.
[27] Décision n° 2019-774 QPC du 12 avril 2019, §. 17. Société Magenta Discount et autre [Contrôle des prix et des marges en Nouvelle-Calédonie] ; v. également §. 32.
[28] Ibid., §. 21.
[29] Ibid., §. 35.
[30] Ibid., §. 38.
[31] CE Ord. 4 avril 2019, France Télévisions, N°s 429370, 429373, 429374.
[32] Benjamin Meffre, « Débat des Européennes : Les invitations forcées de Hamon, Philippot et Asselineau annulées par le Conseil d’État », Pure médias, 4 avril 2019.
[33] Olivier Petitjean, « Lobbying au Conseil constitutionnel : une inaction coupable », Observatoire des multinationales, 9 avril 2019, http://multinationales.org/Lobbying-au-Conseil-constitutionnel-l-inaction-coupable, Consulté le 10 avril 2019. Cette bataille d’organisme de la société civile pour la transparence de l’activité juridictionnelle s’inscrit dans une mouvance générale où la transparence des institutions publiques en général est exigée. Sur ce point, l’affaire Selmayr qui oppose la Parlement européen et la Commission européenne est une belle illustration : Marie-Laure Basilien-Gainche, Antoine Vauchez, Sébastien Platon, Guillaume Sacriste, « Affaire Selmayr : les eurodéputés lancent la campagne », Tribune, Libération, 7 avril 2019, https://www.liberation.fr/amphtml/debats/2019/04/07/affaire-selmayr-les-eurodeputes-lancent-la-campagne_1719946?fbclid=IwAR20uim0EtKquYEphlrYhRodn6mR44X46tFS9cvBIpcyPBXoA639Ht6nOvc, Consulté le 10 avril 2019.
[34] V. le plaidoyer de Denys de Béchillon, Réflexions sur le statut des « portes étroites » devant le Conseil constitutionnel, Les notes du Club des juristes, Janvier 2017, 73 p.
[35] CE 11 avril 2019, Association Les Amis de la Terre France, N° 425063 ; v. aussi « Lobbying: rejet du recours des Amis de la Terre contre le Conseil constitutionnel », Libération, 11 avril 2019, https://www.liberation.fr/direct/element/lobbying-rejet-du-recours-des-amis-de-la-terre-contre-le-conseil-constitutionnel_96304/, Consulté le 15 avril 2019.
[37] CE Ass. 17 avril 1953, Falco.
[38] Texte qui a inséré un article 45-2 à l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
Ajouter un commentaire